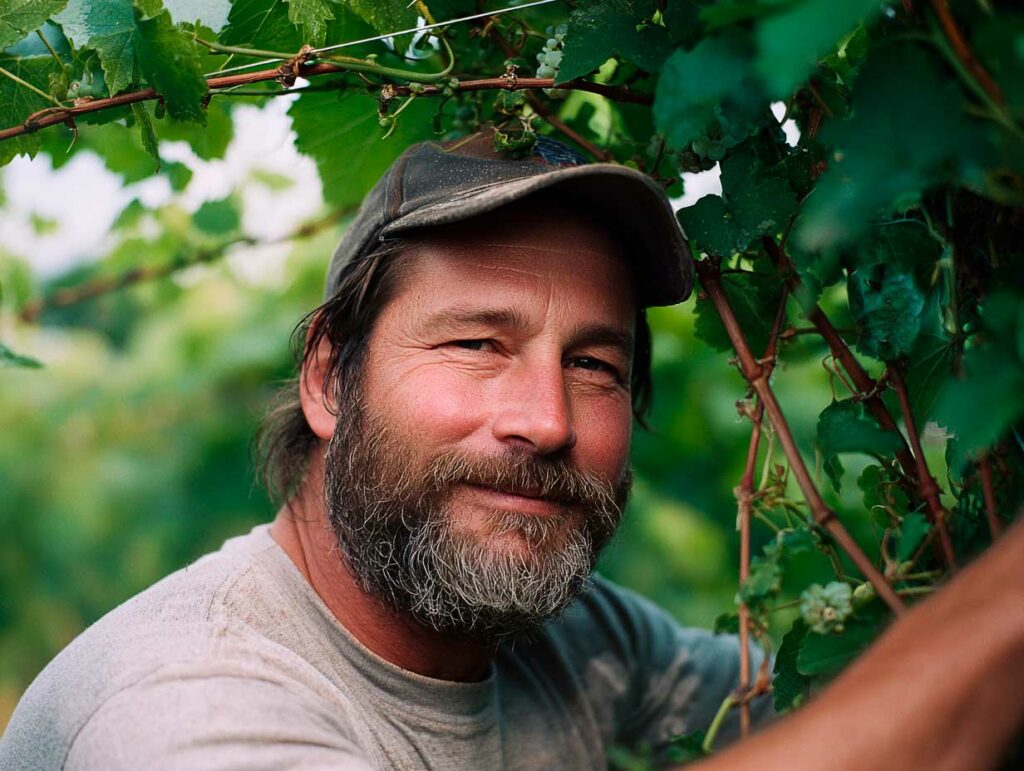Récoltes moroses à Bordeaux malgré un millésime 2025 prometteur
Malgré des raisins de belle qualité, Bordeaux pâtit d’une offre excédentaire, de chais saturés et de prix en recul. Où en est la sortie de crise ?
En résumé
Les vendanges 2025 démarrent tôt dans le Bordelais avec des jus jugés très qualitatifs. Pourtant, le moral reste bas : des chais pleins freinent les ventes, les prix de cession reculent, et la trésorerie se tend. À l’échelle mondiale, l’OIV mesure en 2024 une production estimée à 226 mhl pour une consommation de 214 mhl, soit un surplus d’environ 12 mhl. En France, le diagnostic sectoriel évoque jusqu’à 100 000 ha potentiellement excédentaires. Bordeaux, premier vignoble AOC du pays, a déjà engagé des arrachages et pourrait passer durablement sous 100 000 ha revendiqués. L’arrachage de vignes est désormais appuyé par un plan national validé par Bruxelles (enveloppe 120 M€ ; aide forfaitaire 4 000 €/ha), en complément d’aides de distillation de crise mobilisées dès 2023. Les prix du prix du vrac restent sous pression (tonneaux < 700 € pour certaines transactions, vrac autour de 200 €/hl sur des segments). La campagne 2025 pose donc l’équation : valoriser un millésime de qualité, tout en accélérant l’ajustement de l’offre et la montée en gamme, sous peine d’une nouvelle année de pertes pour une partie des exploitations.
Le millésime 2025 : une qualité saluée, des volumes mesurés
Les vendanges 2025 sont marquées par une précocité inhabituelle et des rendements globalement modestes. Les premiers jus présentent une trame fraîche, concentrée, avec un bon équilibre alcool/acidité malgré la canicule d’août. Plusieurs dégustations de jus confirment des profils nets, porteurs d’un potentiel d’élevage intéressant. Sur le terrain, l’ambiance reste pourtant « morose » : beaucoup de producteurs entrent en récolte alors que leurs chais n’ont pas été suffisamment déstockés en 2024–2025. Le constat revient chez les opérateurs : « chais pleins, pleins, pleins », ce qui pèse sur les négociations et ralentit les mises.
La mécanique d’une crise d’offre : un excédent mondial persistant
À l’international, 2024 se caractérise par un écart production–consommation non résorbé. L’OIV estime la production mondiale à 226 mhl pour 214 mhl consommés, soit près de 12 mhl d’excédents et un plancher historique de consommation depuis les années 1960. La demande recule notamment en Chine, tandis que la valeur se maintient mieux que les volumes grâce à des prix moyens élevés à l’export. Ce différentiel, même ramené à 5–6 % de la consommation, suffit à alimenter des stocks et à freiner la reconstitution des marges des bassins excédentaires en rouge, au premier rang desquels Bordeaux.
Les chiffres du Bordelais : surfaces en baisse, prix sous pression
Bordeaux reste le premier vignoble AOC français, avec environ 103 200 ha revendiqués en 2023 et un passage sous 100 000 ha envisagé après la seconde vague d’arrachages. Depuis 2023, près de 18 000 ha auraient été retirés (toutes mesures confondues), et la « surface de revendication 2025 » est annoncée en clair recul. Sur le marché, la pression est visible : une part des échanges en tonneau passe sous 700 € (deux fois sous le prix de revient modélisé par la Chambre d’agriculture), tandis que sur certains segments, le vrac se traite autour de 200 €/hl. Au détail, des bouteilles d’entrée de gamme à 1,66 € ont nourri la grogne des producteurs. Ces signaux convergent : l’ajustement de l’offre reste en retard sur la demande adressable.
Les chais saturés : un verrou financier et commercial
Des stocks élevés bloquent la rotation et renchérissent le coût de portage (assurances, énergie, trésorerie immobilisée). Ils compliquent aussi les transactions de récolte en cours : négociants et caves coopératives exigent davantage d’alignement sur les prix de débouché, avec des clauses plus strictes sur les volumes. Dans ce contexte, les opérateurs les plus fragiles, notamment en AOC génériques et en zones les plus sensibles à la concurrence des vins d’IGP, peinent à écouler au-dessus de leur seuil de rentabilité. Les témoignages de vignerons sur le terrain font état d’arbitrages douloureux : différer la mise, accepter des prix bas, ou céder des parcelles à arracher.
Les outils publics : de l’arrachage à la distillation
Deux leviers se combinent. D’abord, l’arrachage de vignes à l’échelle nationale, validé par la Commission européenne à l’automne 2024 : enveloppe 120 M€, aide forfaitaire de 4 000 €/ha, pour un objectif d’environ 30 000 ha (toutes régions). Les demandes d’aide ont représenté environ 27 500 ha mobilisant près de 109 M€ au printemps 2025. En parallèle, l’arrachage sanitaire girondin s’est déployé en deux vagues. Ensuite, la distillation de crise a été activée dès 2023 (environ 200 M€ mobilisés en France) afin d’assécher une partie des excédents. Ce couple de mesures vise à rééquilibrer progressivement l’offre. ([Ministère de l’Agriculture][5])
Les 100 000 ha « excédentaires » : un ordre de grandeur à affiner
Le chiffre circulant de 100 000 ha excédentaires en France a servi d’alarme pour calibrer les politiques publiques. Les premières remontées FranceAgriMer et les consultations de filière évoquaient plutôt 50–60 000 ha, mais la dynamique de demande et l’hétérogénéité régionale imposent une lecture par bassins. Pour Bordeaux, plusieurs sources tablent encore sur des besoins additionnels d’arrachage pour assainir durablement le marché.
La stratégie de filière : valoriser, segmenter, diversifier les débouchés
Le centre de gravité de la crise reste l’excès structurel de rouges d’entrée/milieu de gamme. Des pistes opérationnelles émergent chez les opérateurs :
- accélérer la segmentation qualitative (parcellaire, certifications crédibles, transparence analytique) pour sécuriser des prix de sortie stables ;
- investir la demande pour blancs secs, rosés, effervescents bordelais à potentiel, sans déstabiliser les AOC historiques ;
- cibler des marchés export moins dépendants de la Chine, en renforçant l’appui marketing là où la valeur à la bouteille reste défendable ;
- mutualiser logistique et énergie pour alléger les coûts de portage et fluidifier la rotation de stock.
Ces orientations, déjà testées par certaines unions et maisons, visent à rompre la spirale volumes bas/prix bas.
Les risques 2026 : qualité sans prix et consolidation accélérée
Si l’assainissement de l’offre n’avance pas au rythme requis, le millésime 2025 pourrait se vendre sans reconstitution des marges. Le risque est double : décapitalisation des exploitations les plus exposées et concentration accrue des volumes chez les opérateurs capables d’absorber la variabilité des prix et de porter du stock. À l’inverse, si l’arrachage atteint l’échelle utile et que la valorisation progresse (en primeur comme en direct domaine), la filière peut retrouver un couple volume/prix soutenable à horizon 2–3 ans.
La feuille de route immédiate : assainir et capter la valeur du millésime
À très court terme, trois chantiers prioritaires se dégagent. D’abord, accélérer l’instruction et le paiement des dossiers d’arrachage pour matérialiser la baisse de potentiel dès 2025–2026. Ensuite, orchestrer un plan de déstockage ciblé sur les références les plus sensibles, en évitant les braderies destructrices de valeur au détail. Enfin, bâtir une communication technique centrée sur les faits (traçabilité, analyses, profils organoleptiques) afin de porter la qualité du 2025 sur les marchés où la demande existe réellement. Le millésime 2025 peut être un appui, pas une garantie : sans réduction d’offre et discipline commerciale, la qualité restera bridée par l’économie du stock.
Cours d’oenologie est un magazine indépendant.